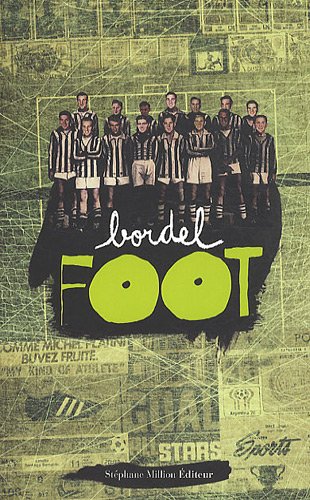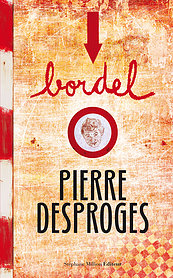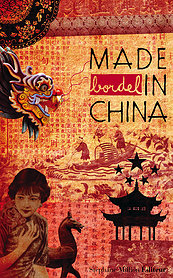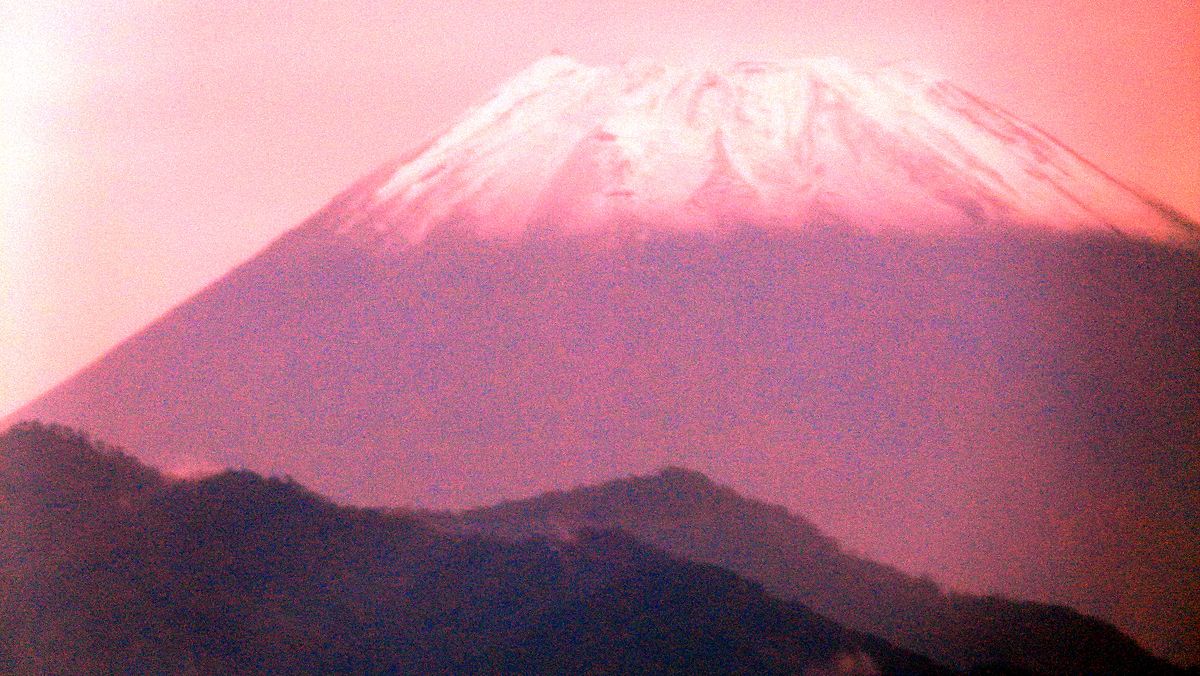Des ballons et des potes a été publiée dans Bordel Foot en 2012 chez Stéphane Million éditeur.
Nous venions de passer trois heures attablés à l’ombre du tilleul, avec pour horizon les oliviers qui se détachaient sur un ciel bleu vif. Les brochettes, les keftés, le kisir, la salade de tomates citronnée et le vin rouge avaient été servis en grande quantité. Nous avions ouvert grand les baies vitrées de la maison, et la vieille chaîne hifi nous envoyait du fond du salon le contenu de nos vieilles compilations datant d’une autre époque. C’était le milieu des vacances, et le temps ne se comptait qu’en mesure de siestes, d’apéros, de piscine, de balades, et ainsi de suite jusque tard dans la nuit, quand la chaleur nous laissait un peu de répit pour nous endormir. Les enfants des uns et des autres avaient rejoint les chambres pour faire la sieste. Et nous digérions tranquillement notre pantagruélique déjeuner, dans un silence recueilli, assis autour de la grande table.
Nous regardions juste le paysage, et nous nous laissions bercer par
les voix des femmes qui discutaient. J’appréciais ces instants où le
temps semblait s’arrêter. Je me sentais comme dans une bulle où rien ne pouvait arriver que des choses douces et agréables.
C’est Pierre, le premier, qui rompit le calme autour de la table : « On
se fait une petit foot les gars ? » Il nous observait les uns les autres, attendant que nous acceptions de relever son défi. La proposition n’emballa personne. Et comme notre réponse se faisait attendre, il nous montra son impatience en nous prenant à partie à tour de rôle pour nous embrigader dans le jeu. Il essaya d’abord de nous amadouer avec des «Mon Titi», «Allez mon ptit Thom», «Polo un petit
foot tranquille?». Il était toujours amusant de voir ce grand gaillard
d’un mètre quatre-vingt-dix prendre une voix douce, tout ça pour
aller jouer. Les adultes restaient toujours des enfants. Quelques
réponses se firent entendre mollement: « Il fait trop chaud», « Je
me ferais bien une tite sieste avant », «Bof»…
Autant vous dire que la voix douce de notre ami Pierrot se raffermit
tout à coup. Nous nous fîmes traiter de larves, de lopettes, qu’on
pourrait se bouger le cul de temps en temps. Le copieux repas et
les bouteilles de Corbières, qui nous avaient accompagnés depuis
l’apéro, nous avaient passablement assommés. Pas lui. Il n’abandonnait pas devant notre paresse : «Allez, bande de loques, on se le fait ce foot ?? »
J’observais les uns les autres. Polo somnolait sur le transat. Julien
avait rapporté à table le sixième tome d’une saga de science-fiction
commencée au début de l’été. Hervé s’amusait, avec son nouvel appareil, à faire des photos de Cyril, qui restait impassible, le bob de sa fille vissé sur la tête. Quant à moi, je terminais ma cigarette, attendant que quelqu’un prenne une décision. Quant aux femmes, elles poursuivaient leur conversation, nous prenant parfois à témoin. Elles savaient qu’elles n’étaient pas conviées à la partie et ne voyaient
pas l’intérêt de prendre part au débat. L’attente devenait insupportable pour notre ami Pierrot qui finit par nous lâcher un « Faites chier les gars…» désabusé.
J’éteignais ma cigarette dans le cendrier, tout en me redressant sur
ma chaise. Avec la chaleur, l’effort me parut surhumain et je regrettais par avance ce que j’allais dire : «Ok Pierrot, on se fait un foot, mais tu fais le café d’abord. » J’obtins un succès d’estime rapport au café, très vite rattrapé par Sophie qui se dévoua pour nous préparer le breuvage demandé.
L’un d’entre nous ayant accepté la partie, les autres suivirent plus
facilement. Nous avons donc quitté la table de la terrasse avec toute
l’énergie dont nous étions capables : celle du macaroni trop cuit.
Il faisait quand même chaud pour ce genre d’activité. Cyril bailla à
gorge déployée pour se réveiller, et le petit groupe se retrouva au
milieu du jardin. Il fallut choisir l’endroit, délimiter le terrain, et, récupérer le ballon caché au fond d’un coffre d’une des voitures.
Nous n’étions pas assez nombreux pour faire une partie classique.
Et il fut décidé à la majorité que nous jouerions une allemande. Une
« allemande » donc, c’est une partie de foot resserrée. Où les
réglementations de l’UEFA n’ont pas cours et où l’arbitrage est en
autogestion. Ici c’est la règle du chacun pour soi. Chaque joueur
démarre le jeu avec une valeur de point définie avant le début de
la partie. Celui qui conserve au mieux cette valeur gagne le match.
Pour jouer et marquer des buts, il vous faut savoir jongler. En effet, vous ne pouvez tirer que si l’on vous fait une passe en jongle, et
que vous réussissez à jongler à votre tour. Vous suivez ?
En ce qui me concerne, il m’a fallu du temps. Et puis je ne suis pas
le plus sportif du groupe. La preuve: en gym, je me traînais deux
de moyenne au lycée, et des mots d’excuses en veux-tu en voilà.
Mais je m’égare. Quand le gardien encaisse un but, il perd de son
capital point. Mais pas un point par but. Le nombre de points
perdus varie en fonction de la façon dont il a été marqué. Un simple
coup de pied n’aura pas la même valeur qu’une tête ou un lobe par
exemple. Si vous perdez le ballon lors d’une action, un dribble, un
jongle… vous prenez la place de gardien. Inversement, le gardien
peut reprendre place dans le jeu, si lors du dégagement, il oblige
un des joueurs à faire une faute et perdre le contrôle du ballon.
La technique la plus souvent utilisée est le shoot violent dans le
dos… Peuvent être également visées: les côtes, voire les parties sous
la ceinture pour les moins chanceux. Ainsi à chaque dégagement,
l’équipe sur le terrain court dans tous les sens pour éviter le projectile. De préférence, il vaut mieux utiliser des ballons en mousse.
Quant à pourquoi dit-on «une allemande », ne me demandez pas. Je n’en ai pas la moindre idée. La tradition de « l’allemande » remonte aux années lycée aussi loin que je me souvienne. Peu importe la soirée, la journée, dans la cour, dans les fêtes chez les uns ou chez les autres, si un ballon avait le malheur de traîner dans les parages, il était bon pour y passer. Chaque fois, nous n’échappions pas à cette coutume de nous confronter les uns aux autres, comme pour mesurer notre
capacité à surpasser l’autre, un ballon au pied. C’était toujours plus
amusant que de réviser ses cours.
Déjà tout petit, nous nous rêvions partenaires d’Olive et Tom, frappant
le ballon avec force, pour faire trembler les filets et impressionner les filles. Nos idoles s’appelaient Cantona, Papin, Wadle, Boli, Raï,
Romario et bien sûr Maradona. Le moindre bout de terrain en terre,
bitume ou en gravillon était notre terrain de jeu. Avec les années,
évidemment, les tacles, les coups d’épaules se faisaient moins vio-
lents. Mais les parties s’endiablaient toujours, jusqu’à que nous
tombions de fatigue, souvent au coucher du soleil et l’appel à la
table par nos parents.
Le ballon rond est un compagnon formidable. Il est capable d’occuper des heures durant une troupe de mecs. Il crée un lien entre les
nouveaux venus dans la bande et les anciens. Il permet de gagner
ou de perdre des galons au sein d’un groupe. Et pour l’anecdote,
il était également d’une grande aide, lors de nos vacances en
camping, pour draguer les jolies touristes hollandaises qui passaient à proximité. Le tout était de bien viser. Les concours de jongles n’étaient pas en reste, mais n’engageaient qu’une personne à la fois, laissant aux autres le soin de s’entraîner à la pétanque. C’était aussi un bel objet de discorde. Combien d’engueulades, combien de prises de tête avons-nous vécu ? Aucun d’entre nous ne serait capable de le dire. Mais ces fâcheries ne duraient jamais bien longtemps.
À ce jeu, les femmes de notre bande étaient insensibles, et il restait
notre dernier bastion, exclusivement masculin. Ainsi, nos compagnes et amies préféraient nous regarder, se moquer, parler de nous profitant de notre absence d’attention à leur égard. Sans les enfants au milieu, nous pouvions maintenant nous permettre coups bas et langage fleuri.
Ces matchs sont l’occasion de régler quelques comptes que l’amitié,
aussi forte soit-elle ne résout pas. Un coup vache à l’adversaire est
une façon de lui rappeler qui domine l’autre, ou que la crasse de
l’autre jour n’est toujours pas digérée. Bizarrement, nous n’avions jamais joué de tour de vaisselle ou de ménage lors de nos parties.
Peut-être avions-nous peur de nous retrouver collés à chaque fois?
Ainsi donc nous voici, vaillants gladiateurs trentenaires en pleine
digestion, sous un soleil de plomb, pour certains en tongs, pour
d’autres clope au bec, prêts à s’affronter dans un match sans pitié,
digne des plus grandes finales de Coupe du monde, avec les encouragements des cigales, hurlant leur joie comme le plus beau des
publics. Et nous voilà partis, dans nos premières actions.
Je vous passe rapidement ce moment de la partie, car il s’agissait
là d’un échauffement, pour rester poli. Le gardien lui-même était
plus occupé à nous regarder nous escrimer à faire des passes correctes, qu’à arrêter nos tirs cadrés. Et les plantes du jardin devaient
prier pour ne pas finir en compost avant la fin de la journée.
Il faut dire que nous étions un peu rouillés. Nous ne jouions plus autant qu’avant. La vie de bureau, le manque de partenaires et pour certains la vie urbaine, ne se prêtaient pas à la pratique de ce sport.
Me voilà dans les cages. Je m’y suis retrouvé rapidement. Le contrôle
du ballon n’était pas aisé. Et je m’enfonçais des petits cailloux
dans la plante des pieds à chaque déplacement. Pierrot de toutes ses
forces m’envoya le ballon dans la tête. Superbe arrêt malgré moi…
Il explosa de rire et tenta entre deux hoquets de s’excuser, pendant
que je me remettais. Je profitai d’un instant d’inattention pour lui
dégager le ballon direct sur la tronche. Loupé. Les géraniums, eux,
risquaient de ne pas s’en remettre. Hervé tenta de jongler tant bien
que mal, mais la taille du terrain n’était pas adaptée à ses grandes
jambes. Il finit par passer le ballon à Polo dans un geste technique
digne d’un joueur brésilien. Et Polo en profita pour tirer… à côté.
En tant qu’auteur du tir, il fut missionné pour récupérer le ballon
dans la haie. Il gagna par la même action la place de gardien. On en profita pour faire une pause. La partie durait depuis déjà cinq bonnes minutes et nous transpirions déjà à grosses gouttes.
Le ballon rejoignit à nouveau l’aire de jeu, la partie pouvait reprendre. Cyril récupéra le ballon et tenta de le dégager vers moi, mais Hervé qui mesurait une tête et demie de plus le récupéra. Polo se retrouva en pleine ligne de mire, il s’attendait au boulet de canon, mais le fourbe de Julien le feinta et le loba. But. Pendant que tout le monde discutait la valeur du but, j’en profitai pour abandonner mes tongs.
Geste que je regrettai très vite. Ces dernières ne me protégeaient
pas des cailloux mais c’était mieux que rien. Et puis j’ai toujours
eu deux pieds gauches au foot. C’est embêtant pour un droitier.
C’est pour ça que, dans les parties classiques, la place de gardien
m’avait toujours convenu. L’énorme avantage du poste, c’est que si
on arrête le ballon, on est le héros de l’équipe. Et s’il passe, vous
pouvez pourrir vos défenseurs en leur disant qu’ils ne font pas leur
boulot correctement.
La partie se poursuivit à coup de tirs non cadrés, de dribbles, de
pertes d’équilibre, de chutes, de fous rire, de moqueries… Je me
retrouvai à nouveau dans les cages et je voyais descendre en flèche
mon capital point. Heureusement d’ailleurs car cette chaleur me flinguait toute envie de continuer. J’attendais avec une certaine
impatience la fin de la partie, rêvant à une sieste paisible et à un verre de rosé bien frais. Après tout, il fallait bien garder des forces pour la partie que nous jouerions le soir.
En nous regardant jouer comme nous l’avons toujours fait depuis que nous nous connaissons, je me demandai s’il en serait de même dans trente ou quarante ans, quand nous serions des grands-pères. Est-ce que des infirmières nous courraient après, alors qu’armés de nos déambulateurs nous ferions une allemande dans le hall d’entrée de la maison de retraite? Je nous le souhaitais vivement en tout cas.