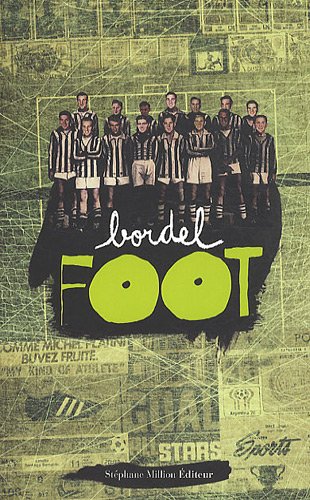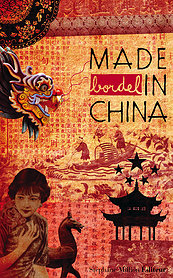J’ai écrit cette nouvelle au mois de mars 2018, pour ma seconde participation au concours de nouvelles pour les Rencontres culturelles d’AltaLeghje en Corse. Le thème était « La montagne »… La voici.
«Une foutue montagne, mon gars ! Elle a avalé cet homme ! Aussi sûr qu’il n’y a qu’une rue dans ce village !». La sentence, grave, avait tonné dans la voix du propriétaire du café. « Pour sûr qu’elle a pris Lucas, pour sûr… Et si vous ne me croyez pas, Georges va vous le confirmer quand il va revenir». C’est pour cette histoire que j’étais arrivé par la route départementale. Mon préhistorique break Volvo avait puisé dans ses dernières ressources pour franchir les deux cols. Au sortir de la forêt s’était offert à mon regard un paysage identique à celui des plaquettes de beurre, avec au loin un village et son clocher, le tout dominé par une montagne. Un collègue, qui y avait passé des vacances quelques mois plus tôt, m’avait raconté un fait divers qui m’avait interpellé. Je me trouvais en manque d’histoires à raconter. Pour contrer l’angoisse de la page blanche, je me rabattais sur cette légende locale, derrière laquelle, sûrement, se cachait une histoire bien banale, mais au cas où…
Je garais ma voiture sur la place du village et me dirigeais vers l’unique grand rue, qui montait vers une église austère. Église qui s’interposait entre la montagne et moi. Et je commençais mon enquête par le lieu où toutes les infos se croisent : le café. Un type aussi balèze et aimable qu’un ours m’avait servi un pastis quasi pur dans un verre Duralex. Et s’il avait d’abord hésité à me répondre, il avait fini par me lâcher ce que je voulais entendre, avec une certaine jouissance : cette montagne à priori inoffensive avait bel et bien fait disparaître un type par une belle journée de juillet. Le fameux Georges dont le tenancier me parlait était l’autre type, celui qui était revenu. Et depuis dix ans chaque jour, Georges montait chercher une trace de son compère disparu. Le soir tombait justement et il n’allait pas tarder à revenir. J’allais l’attendre dehors, histoire de dissoudre par une petite marche l’alcool pur passé dans mes veines. Elle fut rapide. En effet, une seule grand rue qui monte, quelques commerces miraculés, des maisons grises aux volets clos, attendant des jours meilleurs pour se réveiller, et des chiens et des chats qui allaient et venaient. On pouvait entendre les grillons dans les champs alentours. Une douce lumière baignait le village. Le temps s’était suspendu. Plus une brise, ni un chant d’oiseau. La cloche de l’église a sonné l’angélus. Il était sept heures passé . J’ai vu mon rendez-vous s’approcher, tête baissée, bâton de marche à la main, cheveux et barbe hirsutes…Un fou sorti de nul part. Un esprit de la forêt.
«Les gendarmes l’ont soupçonné longtemps et même encore aujourd’hui, on se demande si c’est pas lui qui a poussé Lucas dans un ravin » avait soufflé le patron derrière son bar en se penchant vers moi, pour que d’autres clients qui n’étaient pas là ne puissent pas l’entendre. Georges, les yeux dans le vague et la peau tannée par le soleil ne m’a pas souri quand je l’ai accosté, mais sans hésiter, il m’a invité à m’asseoir près de la fontaine. Je crois qu’il trouvait rassurant de pouvoir raconter son histoire à qui voudrait l’entendre. « C’est moi qui ai prévenu la gendarmerie. Le jour même, quand j’ai enfin retrouvé le chemin pour descendre. Depuis que je suis enfant, je vois cette montagne, plein de gens la montent et la descendent en été. Même si elle change d’humeur avec la météo, ça n’a jamais été l’Everest, vous comprenez ? ».
Ses yeux sombres ne se détachaient plus des miens. J’acquiesçai. Il reprit. « Lucas c’était un copain, un vrai. Avec un cœur gros comme ça, qui me laissait toujours 20 mètres derrière quand on partait. Je revois encore son sac à dos rouge et gris. Il est gravé dans ma mémoire, parce que c’est tout ce que je voyais de lui quand nous partions, son sac à dos rouge. Il buvait et fumait comme moi, mais une fois lancé, il distançait tout ce qui bouge. On était partis dans l’après-midi. Le chemin est facile jusqu’à l’approche du sommet mais il est long. Mais une fois là-haut, j’ai senti la brume et j’ai voulu faire demi-tour. Non qu’il m’a dit. Et qu’on verra rien, je lui ai répondu. Têtu comme une bourrique. Mais j’y suis allé. C’était… C’était comme un frère. Vous comprenez ? » Je hochais simplement la tête. « Une fois là-haut, évidemment, on voyait pas à 2 mètres devant nos pieds et ce putain de chemin était balisé toutes les morts d’évêques. Pour redescendre par le nord, c’était comme les pâturages pour les bêtes, mais en pente douce et sans repère. Et par le sud, de la caillasse glissante en pente raide. On a pris le nord, Il est parti devant, comme d’habitude. Moi, j’ai failli tomber dans un trou. On entendait les cloches des vaches au loin mais avec l’écho, impossible de savoir où elles étaient. Je voyais son sac à dos rouge comme un phare et le son de sa voix. Je faisais pas le malin. Et puis il s’est retourné pour me parler. Bon dieu, j’en suis certain : il m’a souri et il m’a dit on va rebrousser chemin. Et j’ai vu la brume se refermer sur lui. D’un coup. Comme je vous vois. J’ai pas compris tout de suite. Je l’ai appelé, marché dans la direction où je l’avais vu. J’ai eu peur, à m’en pisser dessus. J’ai tourné 3 heures et je sentais le jour tomber. J’ai quand même retrouvé le chemin et je suis rentré. Arrivé en bas, la brume avait disparu. J’ai prévenu les gendarmes. Hélico, chiens,… On l’a cherché des jours et des jours. Pas de corps, pas de sac rouge. Pas une empreinte de pas dans une bouse. Comme si il avait jamais existé… Pourtant, j’ai continué à chercher… »
Il y eut un long silence. Il regardait l’eau qui coulait de la fontaine. Je lui ai demandé s’il y allait tous les jours, là-haut. Il a fait oui de la tête. Quand je lui ai demandé si depuis dix ans, il ne s’était pas fait une raison, il m’a répondu : « Lucas est là-haut. Je le sais et je le trouverai ». Quand je lui ai demandé si il pouvait m’y emmener à l’occasion, il m’a répondu d’un grognement que j’ai pris pour un peut-être. Il est rentré chez lui, tête basse. Ce soir, là, j’ai pris une chambre au-dessus du café car la brume descendait sur le village.

photo © Gaudéric Grauby-Vermeil / Instagram @gauderic7