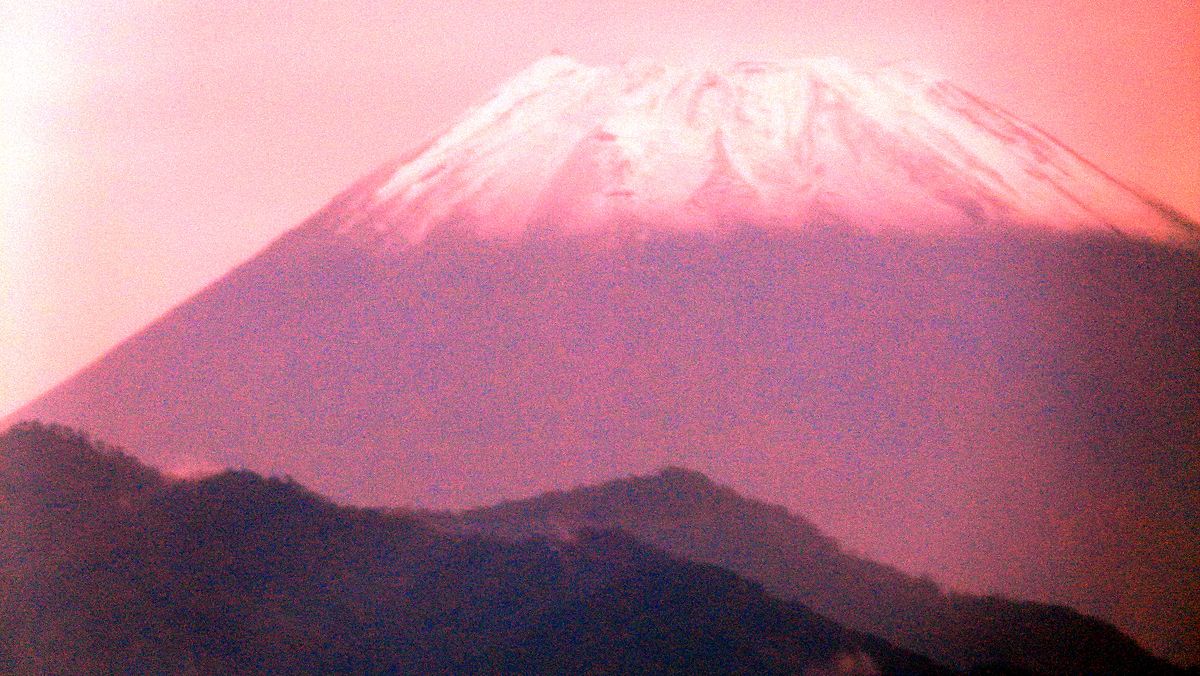Bons baisers du Japon a été publiée dans Bordel Japon en 2011 chez Stéphane Million éditeur.
Photo : Mont Fuji par Brücke-Osteuropa – Wikicommons
Janvier n’en finit pas. Le froid de Paris me mord le moindre centimètre carré de chair qui lui est offert, et la pluie fine me glace les os, malgré ma dernière doudoune à la mode. Je rentre chez moi, et il fait déjà nuit. Cette nuit qui ce matin m’a accompagné vers le bureau. J’accumule la fatigue et les heures sans sommeil. Dans le métro, chaque sonnerie annonçant la fermeture des portes de la rame me rapproche un peu plus de la maison. Un simple coup d’œil autour de moi et je vois la même lassitude dans le regard de mes contemporains. Seuls quelques touristes, fraîchement débarqués à la station Montparnasse, se marrent comme des baleines avec leurs sacs et leurs appareils photos. Leur joie d’être là m’agace et me touche à la fois. Moi aussi, la première fois que j’ai pris le métro parisien, j’avais le sourire. Je ne leur donne pas six heures avant d’être frappé du syndrome de Paris. Quant à moi, ma dernière ambition de la journée est de rentrer et de fermer la porte, être au calme avec ma télé et mon plateau-repas. Comme tous les autres zombies autour de moi.
C’est avec un soupir de satisfaction que je passe la porte d’entrée de l’immeuble, véritable sas de décompression avec le monde extérieur et premier élément réconfortant après une heure de trajet en transport en commun. Je passe mécaniquement devant l’alignement de boîtes aux lettres, preuve que d’autres individus partagent avec moi une vie en ces murs. J’ai pour habitude de jeter un œil à la mienne, et de ne l’ouvrir uniquement que si j’y aperçois une enveloppe, ou des prospectus. Mon courrier est rare. L’e-mail a remplacé le papier et je ne reçois que quelques factures, des publicités d’artisans et autres sorciers vaudous. Rien d’intéressant si ce n’est des promesses de vie meilleure et des échéances financières.
Ce soir, pourtant, ma boîte aux lettres laisse entrevoir un courrier de taille inhabituelle. J’ouvre et récupère la missive sans y jeter un œil, trop pressé que je suis de rentrer au chaud. Maneki m’attend. Assis devant la porte avec l’œil interrogateur, il miaule une fois, me faisant part ainsi de son mécontentement de me voir encore rentrer après l’heure syndicale pour sa gamelle. Je m’excuse plate-ment, caressant sa tête qu’il dégage aussitôt pour filer en direction de la cuisine. Je jette mes affaires sur le canapé, et je file nourrir le fauve blanc, qui miaule de plus belle, se frottant contre mes jambes pour me faire accélérer le mouvement. Une fois servi, il ne s’intéresse plus à moi, m’autorisant alors à vaquer à mes occupations du soir. Je m’en vais sous la douche oubliant le courrier et le reste de mes affaires sur le canapé. Au milieu des vapeurs d’eau chaude, je tente d’oublier les contrariétés de mon quotidien.
Emmitouflé dans mon peignoir, je me poste à la baie vitrée, pour observer le monde extérieur. J’allume une cigarette. J’allume ma télé. Dernier point, je démarre aussi l’ordinateur. Comme si l’appartement se métamorphosait en vaisseau spatial. Comme s’il ne pouvait pas prendre vie sans tous ces artifices et ses écrans de contrôle. Maneki, mon seul compagnon à bord, s’installe dans le canapé et commence sa toilette du soir, consciencieusement. Je visite mon frigo désespérément rempli de n’importe quoi. Il me faut puiser dans mes dernières ressources de créativité pour lancer un dîner correct, sans avoir à piquer les croquettes du chat. J’écoute mes messages de répondeur tout en dînant, le téléphone au creux de l’épaule, et l’œil rivé sur la télé. Le dîner est avalé en quelques coups de fourchette. J’abandonne mon assiette sur un coin de la table basse et je reporte l’heure du dessert à plus tard.
J’aperçois ce que j’identifie maintenant comme une carte postale. Elles sont rares celles qui atterrissent dans ma boîte aux lettres. Non pas que les gens ne voyagent plus, mais plutôt qu’ils donnent tous de leurs nouvelles sur internet, via leurs blogs ou leurs sites. Alors qui m’envoie cette carte postale ? Mon cœur bat la chamade au moment de la déchiffrer. Elle est assez rigide et le papier est jauni artificiellement pour lui donner un côté authentique. Elle représente une estampe japonaise, où le Fujiyama se détache, rouge sang, contrastant avec l’hiver qui fige Paris. Je devine, sans l’avoir lu, l’identité de l’auteur.
Je regarde l’estampe comme si je cherchais quelqu’un dans le décor. Quelqu’un que j’attends et je fuis à la fois. Je sais que je ne veux pas la retourner mais qu’il faudra le faire, ne serait-ce que pour savoir si j’ai vu juste. J’en veux aux postiers de France et du Japon de l’avoir apportée jusqu’ici. Je souhaiterais ne jamais en avoir eu connaissance. Qu’elle se perde au milieu de la Russie. Mais elle est là, attendant d’être lue. Maneki me regarde. « Mon vieux, tu ne devineras jamais qui nous écrit ». Le chat baille à s’en décrocher la mâchoire. « Tu as raison Maneki, on s’en fout ».
Le Japon… à cet instant, le pays du soleil levant rouvre une blessure qui se refuse à cicatriser. Le Japon, pour moi, c’est Juliette. Juliette n’est pas japonaise. Juliette est blonde aux yeux bleus. Et si le Japon est entré dans ma vie sans que je m’en rende compte, c’était à cause de Juliette. Notre histoire est née sous le signe Nippon. La raison en est toute bête. C’est en bas de chez moi, dans un petit restaurant japonais, tenu sûrement par un coréen, que j’étais tombé amoureux d’elle. Je me souviens de ce soir-là. J’étais passé prendre de quoi dîner en rentrant du boulot. Elle attendait sa commande au comptoir: début de l’histoire, une histoire à emporter.
Juliette aimait les sushis, la bière Asahi, la maison de la culture du japon et la cérémonie du thé, les films de Kitano, et les fringues japonaises. Elle voulait visiter Tokyo. Et l’Australie aussi. Mais surtout Tokyo. Juliette n’était pas japonaise. Elle n’était jamais allée au Japon, mais elle en rêvait. Tout ce qui venait de là-bas avait à ses yeux une qualité particulière, là où je ne voyais qu’un snobisme citadin, une volonté d’exotisme et de voyage sans jamais quitter son chez soi. Je croyais à une lubie féminine, une mode où toute Française qui se respecte doit aimer le Japon. Le label japonais, c’était la distinction et la légèreté, la délicatesse des fleurs d’un cerisier ou la finesse d’un kimono. Une promesse d’ailleurs, comme dans les catalogues de voyages. Elle se voyait peut-être en Uma Thurman dans Kill Bill, quand elle partait à son cours de judo. Le Japon sonnait dans sa voix comme une aventure palpitante. Jules Gassot, dans son Manuel de savoir vivre à l’usage des jeunes filles, a sûrement raison: le Japon est peut-être l’un des accessoires indispensables de l’imaginaire féminin moderne. Même si dans la majorité des cas, il se limite à manger des sushis.
Je me souviens des dimanches matins où Juliette débarrassait le petit-déjeuner, et s’installait contre moi, avec mon atlas à la main. « On ira », avais-je promis. Sans savoir. Sans dire quand. Et j’apprendrais à mes dépens qu’il ne fallait pas faire de promesse à Juliette, ou alors il fallait être en mesure de réaliser rapidement. La déception chez elle ne laissait pas de place à une seconde chance. Elle avait une théorie sur le couple qui se basait sur la passion et l’inattendu. Il fallait entretenir la flamme chaque jour un peu plus fort, et combattre la routine comme un ennemi mortel. Un combat que je pensais vain.
Quant à moi, le Japon, c’était le Game Boy de mon enfance et le walkman de monsieur Sony, c’était la moto du voisin ou la chaîne hi-fi de mon père. Le Japon, c’était les dessins animés. San Go Ku, Goldorak et les pornos pervers. Je voyais le Japon comme un monde imaginaire et technologique, un peu déjanté sur les bords. Tout ce que cette carte postale, qui se trouve maintenant dans mes mains, n’est pas avec son côté ancien, si traditionnel. Elle m’est envoyée d’un pays qui sort un nouveau téléphone portable tous les trois jours, d’un pays qui a créé les premiers robots. Et pourtant cette carte vient du passé, de mon passé.
Maneki vient se lover contre moi. Il est tout ce qui me reste de Juliette. La seule chose dont je n’ai pas pu me débarrasser. Après tout, il n’y était pour rien. Il a hérité de ce nom à cause de cet amour immodéré de Juliette pour le Japon. Et pourtant lui non plus n’est pas japonais. Mais Juliette avait décidé: ce serait Maneki, comme les chats porte-bonheur qu’on trouve à l’entrée des magasins ou des restaurants asiatiques. À l’époque, nous coulions ce qui me semblait être des jours heureux, rythmé entre travail, weekend à la campagne, soirées entre amis et siestes crapuleuses. Elle me rassurait par sa simple présence, demain me semblait plus facile. J’espérais ces moments éternels. Néanmoins, il m’avait fallu du temps pour laisser aller mes sentiments vis-à-vis d’elle, et faire tomber ma carapace. Notre histoire dura deux ans, sans cris, sans conflits. Et puis je suis rentré un soir, et j’ai trouvé l’appartement vidé de moitié. Elle était partie aussi vite qu’elle était entrée dans ma vie. En souvenir de cette union, elle ne m’avait laissé quelques cheveux au fond du lavabo et une terrible sensation de solitude. Je ne comprenais alorsni son départ, ni ses attentes. Elle m’avait mis devant le fait accompli. Notre histoire s’arrêtait là. Je n’avais probablement pas su l’écouter, ou pas voulu, tout simplement. Comme dans les films romantiques, elle avait voulu rajouter une touche de mélodrame et avait accroché au collier de la pauvre bête un message: « Il te portera bonheur. Désolé. J. ». Et Maneki avait passé le reste de la journée à essayer de se débarrasser de ce bout de papier. Je n’ai donc pu garder que Maneki.
J’allume une nouvelle cigarette. Après son départ, je ne voulais pas entendre parler du Japon, encore moins de Juliette. Un an et demi s’était écoulé et cette colère sourde en moi ne s’était jamais vraiment éteinte. Je lui en voulais d’être partie. Plusieurs fois, elle avait tenté d’expliquer son geste dans des lettres. Et ses raisons ne tenaient pas debout. Elles étaient irrecevables à mes yeux. Mais c’était son choix, et je n’allais pas aller contre sa volonté. Et même si j’avais voulu, je n’aurais rien pu sauver. Je brûlais toute sa correspondance au fond d’un saladier. Et dans une dernière mesquinerie, pour la punir de m’avoir laissé, je lui répondais par mon silence le plus absolu.
Et voilà, Juliette est à nouveau de retour dans ma vie, derrière cette carte, cachée dans le paysage du Fujiyama. Comme une tache d’encre indélébile dans mon esprit. L’odeur de son parfum m’envahit, et des images remontent à la surface, des sensations douces et agréables. Son rire emplit ma tête. Et le fantôme de Juliette traverse l’appartement, sa serviette de bain nouée au-dessus de sa poitrine, ses cheveux en chignon, laissant flotter derrière elle l’odeur de son gel douche si chimiquement délicieux, parfum noix de coco. Me rappelant au présent, Maneki tape avec sa patte sur la carte, comme pour me demander de la lire. Il est inutile de repousser encore un peu plus loin l’échéance.
Je retourne la carte, prêt à affronter cette lecture difficile. Comme dans les mangas, le marteau de 1000 tonnes me tombe dessus par surprise. Mes yeux parcourent chaque ligne, et je me sens de plus en plus bête au fur et mesure. Au fond de mon cœur, j’espérais toujours un signe d’elle. Je me sens stupide. Arrivé à la fin de la carte, je souris. Je me lève et me dirige vers la cuisine. J’accroche la carte au frigo, effleurant du doigt le Fujiyama. Leur budget publicité doit être conséquent pour se payer de si belles cartes postales. Je me promets, ne serait-ce que pour le trouble que m’a procuré cette carte, d’aller dîner un soir dans ce restaurant qui vient d’ouvrir dans le quartier. Cette non-aventure m’a fait ouvrir les yeux sur les histoires d’amour. Quand elles ne sont plus, il faut savoir tourner la page.
Gaudéric Grauby-Vermeil