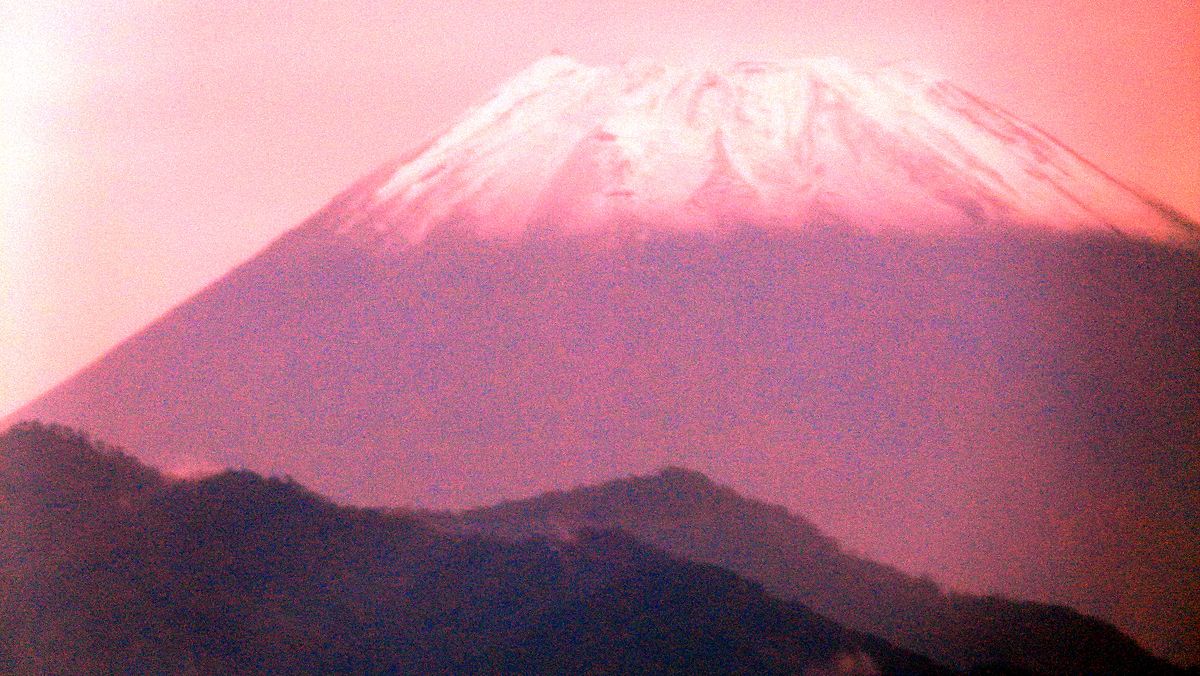C’était un pont, au dessus d’une voie ferrée. Il pleuvait, pardon, il bruinait. Nous étions un weekend de 15 août et mu par un instinct animal, je réfléchissais à des astuces économiques pour améliorer mon chez moi à l’approche de l’hiver. J’avais enfourché mon vélo, une hirondelle, issue des chaudrons de Saint-Etienne. Le vélo de la police quand elle portait encore des capes, comme des super héros. Les moustaches en plus. Je profitais d’un répit météo pour passer entre les gouttes et me rendre au temple du bricolage qui se trouvait près de chez moi.
J’arrivais sur le dit pont et il y avait cette voiture noire. Une petite voiture noire qui était en warning. Et une tête, et des mains, qui s’agitaient à l’intérieur. Personne ne s’était arrêté pour savoir ce qu’il se passait. Elle était mal placée, et les autres voitures la doublaient sans visibilité, trop pressées d’arriver. Mais qu’importe, qui aurait l’idée de s’arrêter pour se mêler de ce qui ne le regarde pas ?
Je m’arrêtais donc à la hauteur du conducteur. De la conductrice en fait. Elle hurlait. Elle suffoquait. Elle hoquetait. Elle couvrait d’injures une personne au téléphone. Elle le menaçait, le traitait de sauvage à s’en faire péter les cordes vocales.
Je sentais bien que ma présence n’avait pas été officiellement remarquée. Je tapais à la fenêtre mais elle me fit signe qu’elle gérait la situation. En fait ses larmes et ses hoquets me signifiaient, eux, qu’elle ne gérait pas grand chose. Alors je fis ralentir la circulation pour éviter un accident. Je gardais une oreille tendue. Vus les décibels de rage déployés à travers l’habitacle, je comprenais que « il » était parti avec les clés. Qu' »il » l’avait laissée au milieu du pont. Qu' »il » lui avait mis « un coup de rétro au visage ». Elle hurlait de plus belle. « Il » raccrochait. Elle rappelait pour l’invectiver encore plus fort et pour réclamer les clés de la bagnole, avec une menace qu’elle n’avait pas mis réellement à exécution : « la police arrive ».
A défaut de cavalerie, j’ai accroché mon vélo au pont. La voiture ne pouvait pas rester au milieu. Je lui expliquais la situation entre deux coups de téléphone. Mais le bon Samaritain est parfois sourd et je ne voulais pas entendre que les roues ne pouvaient être tournées. Alors je poussai la voiture pour lui faire rejoindre le parking en contre bas. Après avoir réclamé, en courant à coté de la voiture, qu’elle veuille bien freiner, la voiture parti tout droit. Et je me rappelai alors que sans les clés, le volant se bloque. Quel imbécile je faisais. Je me raccrochais au fait qu’elle était quand moins exposée.
Elle rappela « il » . Elle avait 20 ans et des poussières. Elle donnait de la voix. Une brune, assez grande. Il lui raccrocha au nez. Je lui demandai où elle vivait, si elle avait des proches dans le coin. Sa sœur. Sa sœur allait venir. Elle cherchait son souffle. Elle portait un legging et chemise ample. Elle avait l’intonation populaire qui me rappelait les filles du quartier dans le sud. Et la rage qui pouvait les animer parfois.
Je me remis à faire la circulation, sans cape, ni sifflet. Enfin quelqu’un s’arrêta. Il avait l’air suspicieux. Avec son accent des pays de l’est, il cherchait à comprendre ce qui se passait, et moi je comprenais le ridicule de la situation. Comment expliquer simplement que la dame était dans une voiture sans clés au milieu de la route, et que si elle était dans cet état, je n’y étais pour rien.
Au loin s’avança alors une montagne. Elle était sur le pont et se rapprochait. Pendant que je parlais, je tournais plusieurs fois la tête, méfiant, pour identifier la menace. Et je savais, à chacun de ses pas, que c’était « il ». Lui avec les clés de la bagnole. Le gars de l’est me dit alors « Ah, son mari ! » et démarra sans demander son reste. Misère de misère. Mais pourquoi fallait il que ce soit une montagne. . . Pourquoi fallait-il toujours que ces types soient des costauds hors catégorie ?
Son regard noir et menaçant se porta sur moi. Et c’est toujours menaçant qu’il préféra diriger son attention sur elle. S’en suivit alors un dialogue de sourds à base de « passe moi les clés, connard » et « Sors de la voiture » avec un « connasse » en sous-entendu explicite. Le type me demanda de partir en me remerciant, sans y croire, mais je ne partais pas. Et je ne savais pas si j’avais raison. Elle sortit, se jeta sur lui. Elle donna des coups pour sortir sa colère. Il la repoussait, il s’en contenait devant ce témoin que j’étais de leur vie mal conjuguée. Ça pouvait péter n’importe quand. Et moi au milieu, venu avec mes petits bras qui se demandait si un dieu avait eu la bonne idée de nous glisser dans le cerveau une technique en cas d’urgence pour maîtriser un gars comme ça. Surtout quand on n’a fait que tennis en sport.
Mon mètre 71 ne ferait pas le poids contre Golgo 13. Et je n’avais pas la fronde de David pour étaler Goliath. Un Goliath en jogging fuseau, sale et moulant ce qu’il considérait sûrement être sa virilité. Coiffé selon le code des footballeurs : long en haut, bien gominé et rasé sur les côtés. En définitive, valait-il mieux vaincre mal sapé ou s’effondrer avec un peu de style ? Et si pour une fois, quand les types de 70 kg parlaient, ceux de 120 pouvaient les écouter ?
Pas très confiant, je lançais, en levant la main comme à l’école, un courageux : « Monsieur, il faut vraiment déplacer cette voiture, c’est dangereux où elle est. »
C’était presque faux évidemment mais, miracle, le pugilat prit fin. J’avais au moins évité qu’il lui en colle une et qu’elle lui crève les yeux. Pour l’instant en tout cas. Il monta dans la voiture, démarra en trombe, lança un doigt d’honneur à la demoiselle et fila en faisant crisser les pneus.
On est restés plantés tous les deux comme des cons. Elle sans voiture, et moi, merdeux, avec l’incertitude de l’efficacité de mon action. Sa sœur, elle, devait venir la prendre quelques minutes après. Je me proposais d’attendre avec elle. Après tout, je n’étais plus à une minute prêt et j’avais toujours ma mâchoire. « Inutile de rester » me dit-elle. Quand je suis repassé avec mon vélo, elle n’était plus là.